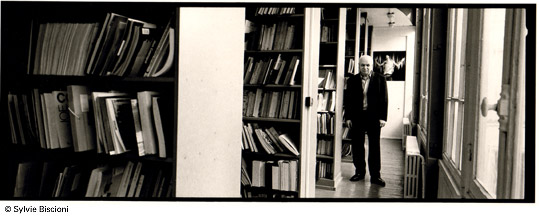
« Retour vers le futur » TINA vous propose de redécouvrir des textes /// 2009
Jean-Claude Moineau, Contre l’art global, pour un art sans identité, éditions ère, 2009
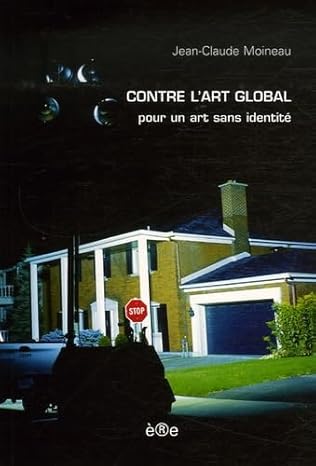
Extrait introduction :
DE L’ART TOTAL À L’ART GLOBAL
Si, déjà en gestation dans le regard panoptique du panorama, l’art total, de la fantasmagorie wagnérienne au fantasmatique et impudent « tout est art » des avant-gardes, s’accordait avec la notion ô combien ambiguë de totalitarisme, après que la « dictature des media » — en liaison avec la culture de masse davantage qu’avec l’art proprement dit— ait permis de faire l’ « économie » de tout totalitarisme stricto sensu, l’art global, le « glob’art », plus ou moins confondu avec la « culture globale », est devenu, en cheville avec le libéralisme, celui de la démocratie post-totalitaire1 de marché que l’occident s’ingénie à vouloir exporter à la planète entière, ainsi que de ce nouvel oxymore qu’est la révolution conservatrice.
L’art global n’est pas tant un art intégral qu’un art intégralement intégré, ayant —après l’échec de ce qu’il pouvait encore y avoir de velléité critique dans le postmodernisme et le constat que toute visée critique se trouve inexorablement absorbée par ceci même dont elle entend faire la critique— abandonné toute dimension critique qui supposerait un ailleurs, s’appliquant sans relâche à faire passer dorénavant toute ambition critique pour réactive.
Tout au plus, quitte à se confiner à un rôle d’animation culturelle, d’entertainment, et à se diluer dans l’industrie du spectacle —mais spectacle qui n’est plus tant coupé de la vie qu’il ne spectacularise la vie elle-même—, l’art global, comme avant lui l’art total, aimerait-il pouvoir illusoirement réenchanter un monde désenchanté, un monde que l’actuelle globalisation —dont il est partie constituante, si tant est que l’on puisse encore le découper en différentes parties— désenchante pourtant toujours davantage. Et ce quand bien même l’art global, ayant renoncé à toute extériorité, est un art qui a définitivement renoncé —plus encore que l’art moderniste— à toute transcendance, qui recherche la source de l’enchantement au sein même du monde et non dans un dehors, qui se complaît dans la plus extrême superficialité.
L’art global, c’est, après les grands défilés hystériques sur des rythmes militaires des régimes totalitaires, l’art des défilés des collections de mode dans les lieux institutionnels de l’art sur des bandes-son mixées par des DJ déjantés ou qui feignent de l’être. L’art global tend à se confondre avec le look. Là où l’art total entendait, de façon tout avant-gardiste à l’encontre du modernisme, faire fusionner l’art et la vie, et la vie tant biologique —relent du vieil organicisme mâtiné de biopolitique— que sociale, ce qu’a, effectivement, pleinement « réussi » à faire à sa façon, en son temps, l’art totalitaire, tant hitlérien que stalinien2, l’art global, lui, est l’art de la confusion généralisée. Confusion de l’art et du non-art, de l’art et de la mode, de l’art et de l’argent, de l’art et de la culture, confusion des arts et des cultures… confusion redoublant celle du temps de travail et du temps de loisir.
L’art global est un art destiné non tant à un public qu’à la fois au marché, en voie de mondialisation, et aux institutions, tant nationales que supranationales. C’est l’art le plus institutionnel qui soit, l’art hyper institutionnel qui a délaissé toute critique des institutions comme de l’art en tant que tel. L’art des grandes messes et kermesses, des grandes foires et foirades internationales de l’art.
La globalisation de l’art, c’est, pour la première fois, la mondialisation effective du « monde de l’art », son extension, sinon à toutes les couches de la ou des société(s) —loin s’en faut—, du moins à la planète entière. À l’encontre des courants artistiques antérieurs, postmodernisme compris, qui ne couvraient qu’une partie relativement restreinte de la planète (quand bien même c’est, historiquement, ainsi que l’indique Pascale Casanova3, le naturalisme qui fut le premier courant artistique à s’étendre à des territoires jusqu’alors inconnus du monde de l’art, en marge du monde de l’art), la catégorie d’art contemporain est pour la première fois une catégorie véritablement globale. Là où l’art avait toujours entendu reculer les frontières de l’art, là où l’art total, en quête, par opposition aux arts modernistes, de synthèse des arts, entendait passer outre les frontières entre les media et les arts, là où l’art des années soixante était devenu un art sans spécification de medium, un « art générique », l’art global se joue non seulement des anciennes frontières entre les media et entre les arts, mais également des frontières géopolitiques, sans toutefois pouvoir les ignorer tout à fait, concentré qu’il demeure dans quelques places fortes surprotégées dans lesquelles se retrouvent périodiquement les acteurs du monde de l’art global qui, avec un bel ensemble, ne cessent de transhumer de l’une à l’autre, telle une volée d’oiseaux migrateurs piailleurs. Flux, tant matériels que virtuels, à la fois d’œuvres, de capitaux et de personnes. Mutation du monde de l’art en réseau de l’art, à la fois réseau marchand et réseau institutionnel, étroitement connectés entre eux, ne faisant en vérité qu’un. Art et culture étroitement mêlés.
Ainsi l’artiste global est-il celui qui, inversant la filière traditionnelle, se fait d’abord reconnaître mondialement avant de se faire reconnaître à l’échelon local (le précédent avait été Marcel Duchamp, refusé par les Indépendants de Paris en 1912, acclamé par la première manifestation internationale d’art « moderne », l’Armory Show, en 1913, mais qui, par « contrecoup », avait su manigancer de toutes pièces son exclusion —sous un faux nom— des Indépendants de New York en 1917). C’est l’artiste mobile, non plus tant le peintre-voyageur ou le photographe-voyageur d’antan que le jet-artist ne résidant le plus souvent pas dans le pays dont il est originaire mais dans l’une des citadelles de l’art global, si tant est qu’il réside quelque part puisque, à l’encontre des artistes de la première partie du vingtième siècle qui vivaient dans l’exil, il doit désormais arpenter sans relâche la planète de part en part. De même que le commissaire de l’art global est celui qui poursuit une carrière internationale le conduisant à occuper successivement des postes dans différents hauts lieux de l’art global et à être en perpétuel déplacement, flexibilité oblige, dans un monde lui-même toujours en mouvement, plus que jamais sans repère fixe. De sorte que ce sont toujours les mêmes qui se répartissent les postes, avec un très fort effet d’homogénéisation sur le « monde de l’art ».
Et, alors que l’art totalitaire était celui où le commissaire politique jouait au commissaire ès arts, l’art global, toujours question flexibilité, est celui où l’artiste (global) joue au commissaire et où le commissaire (global) joue à l’artiste, avec l’exposition à la fois comme œuvre (réduisant les œuvres exposées à de simples matériaux entre les mains du commissaire-artiste) et comme medium (certes « impur », voire « théâtralisé » par la scénographie d’exposition qui se fait elle-même de plus en plus envahissante). Tous deux pouvant, de surcroît, jouer au critique d’art dans un monde de l’art où, précisément, toute critique véritable, faute désormais de la mise à distance et de l’indépendance indispensables –quand bien même, par le passé cette distance demeurait, en son principe, spectaculaire—, se trouve exclue, que ce soit la critique artistique ou l’art critique. De même que, dans l’art total, dès lors que tout était art, plus rien n’était art, dès lors que, dans l’art global, tout le monde se fait médiateur, il n’y a plus de médiation possible (si tant est, même, que le critique ait à se confiner à un simple rôle de médiateur, ce qui tend déjà à vider la critique de tout caractère critique).
Notes :
1 Cf. Jean-Pierre LE GOFF, La Démocratie post-totalitaire, Paris, La découverte, 2002.
2 Boris GROYS, Staline œuvre d’art totale, 1988, tr. fr. Nîmes, Jacqueline Chambon, 1990.
3 Pascale CASANOVA, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999.