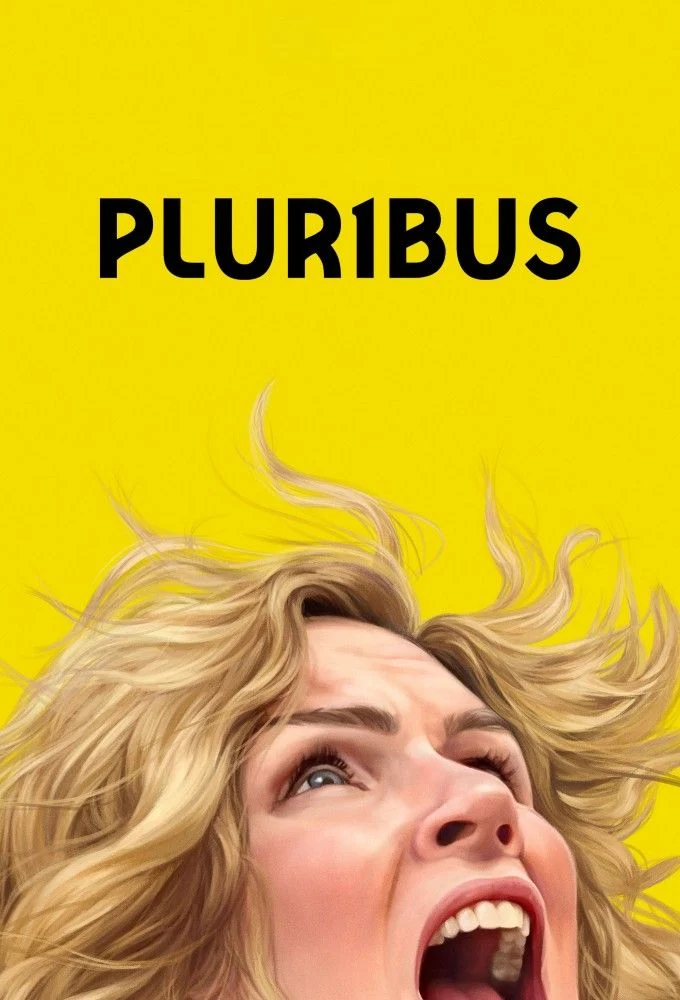Boulevard de la Villette, Paris 10ᵉ, le 17 février 2018
Je mets longtemps à choisir mes vêtements même quand je sais que personne ne me verra vraiment dans la journée. Je bois le café très chaud, presque brûlant. Je préfère écouter la radio plutôt que des playlists. Je garde les fenêtres fermées quand il fait trop chaud. Je m’assois souvent par terre sans raison. Je ne sais jamais quoi faire de mes mains quand je parle. Je garde les boîtes vides parce qu’elles pourraient servir. Je relis les messages avant de les envoyer, puis je les efface avant de les réécrire. Je n’aime pas qu’on me regarde quand je réfléchis. Pareil, quand je dors. Je marche plus vite quand je suis nerveuse. Je garde les tickets de transport dans mes poches. Je me souviens des lieux plus que des visages. Je préfère les lumières indirectes. Je ne supporte pas les voix trop fortes. Je n’aime pas expliquer mes choix. Je garde les livres même quand je ne les aime pas. Je mange rarement à heures fixes. Je m’assieds toujours près des fenêtres. Je regarde les gens sans les écouter. Je n’aime pas qu’on touche mes cheveux. Déjà enfant, je n’aimais que ma grand-mère me pince les joues, même si pour elle c’était un geste affectueux. Je garde tous mes vêtements même s’ils sont trop vieux, usés. Je préfère les marges aux centres. Je m’endors difficilement quand tout est trop calme. Je laisse la vaisselle s’accumuler. Je n’aime pas les compliments directs. Je garde certaines phrases comme des talismans. Je ne sais pas répondre aux questions simples. Je m’ennuie vite quand tout est prévu, organisé, planifié de longue date. Je garde les silences que je ne sais pas remplir. Je repousse certaines décisions jusqu’à ce qu’elles se prennent sans moi. Je me demande souvent si ce que je ressens est visible. Je continue à avancer sans savoir exactement dans quelle direction je vais.
Je me réveille systématiquement quelques minutes avant que le réveil sonne, comme si mon corps cherchait toujours à devancer la machine. Je bois mon café trop vite et je me brûle presque toujours la langue. Je n’aime pas répondre immédiatement aux messages, même quand je suis disponible. Je garde les tickets de caisse dans mes poches pendant plusieurs jours avant de les jeter. Je marche plus lentement que les autres sans m’en rendre compte. Je préfère les escaliers aux ascenseurs, sauf quand je suis vraiment fatigué. Je coupe le son de mon téléphone dès que je franchis la porte de chez moi. Je m’arrête parfois au milieu d’une phrase parce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Je n’aime pas les pièces trop éclairées. Je laisse souvent les livres ouverts à l’envers pour marquer la page. Je regarde les vitrines sans jamais entrer dans les magasins. Je repousse les rendez-vous médicaux tant que la douleur reste supportable. Je mange debout dans la cuisine même quand la table est libre. Je parle rarement de mon enfance parce que je ne sais pas quels souvenirs sont vrais. Je reconnais les voix plus facilement que les visages. Je vérifie plusieurs fois que la porte est fermée avant de sortir. Je garde les objets cassés en me disant qu’ils pourraient servir un jour. Je n’aime pas qu’on touche à mon bureau. Je me souviens avec précision des odeurs mais pas des dates. Je change souvent de place dans les cafés. Je n’aime pas qu’on me regarde écrire. Je note des phrases sur des bouts de papier que je perds ensuite. Je me souviens de rêves que je n’ai jamais faits. Je préfère écouter des histoires plutôt qu’en raconter. Je laisse traîner mes vêtements sur une chaise plutôt que dans l’armoire. Je regarde les gens dans le métro sans imaginer leur vie. Je déteste les alarmes. Je garde des silences trop longs au téléphone. Je parle plus facilement à des inconnus qu’à mes proches. Je n’aime pas qu’on me demande ce que je ressens. Je me couche tard même quand je suis fatigué. Je relis les mêmes phrases plusieurs fois. Je me demande souvent à quel moment exact j’ai commencé à devenir quelqu’un d’autre.
#163 Sur le banc (1)
#167 Sur le banc (2)
#188 Sur le banc (3)
#194 Sur le banc (4)
#199 Sur le banc (5)
#204 Sur le banc (6)
#214 Sur le banc (7)
#221 Sur le banc (8)
Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci