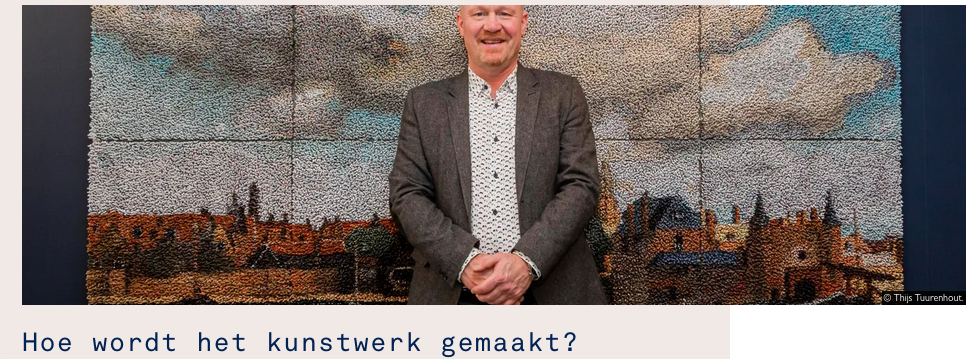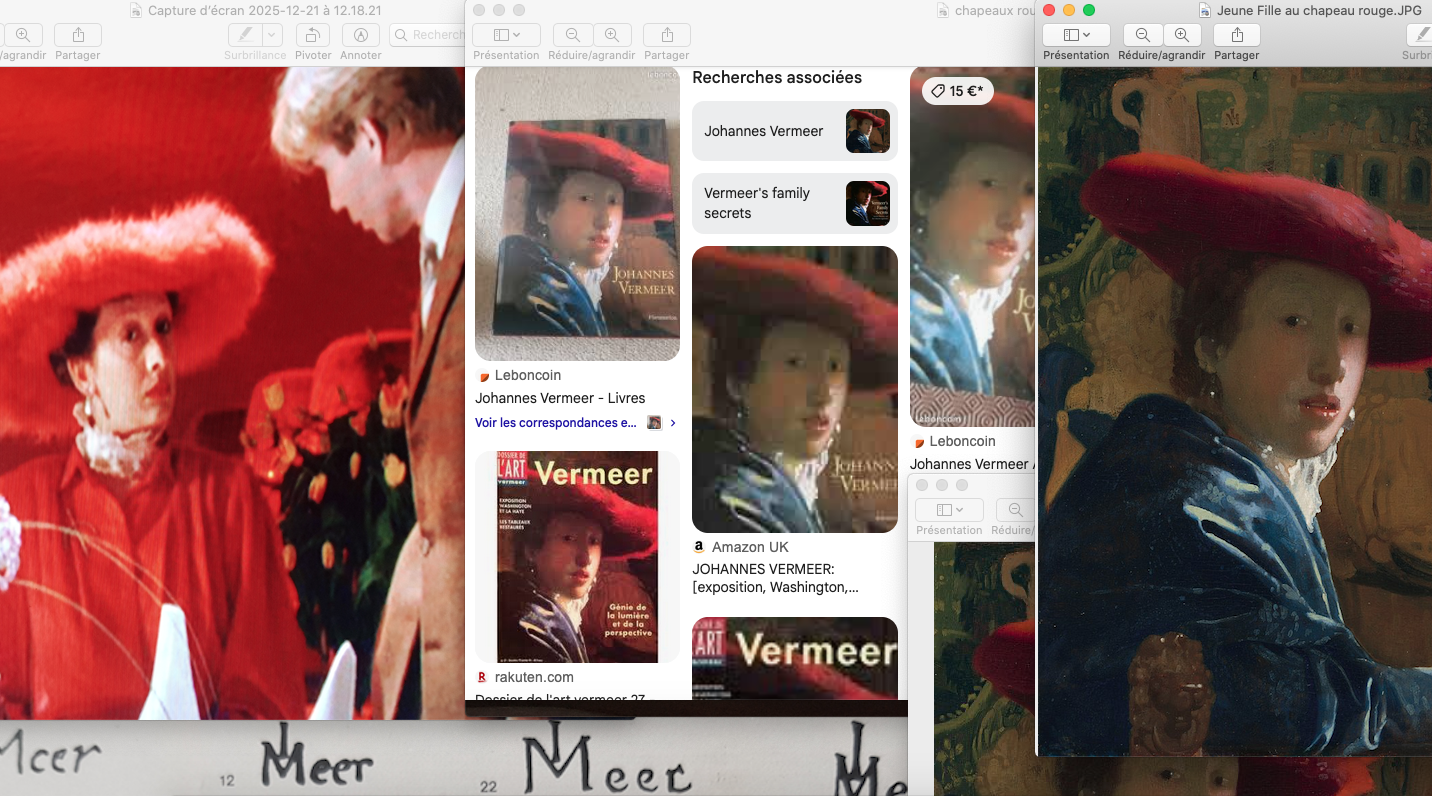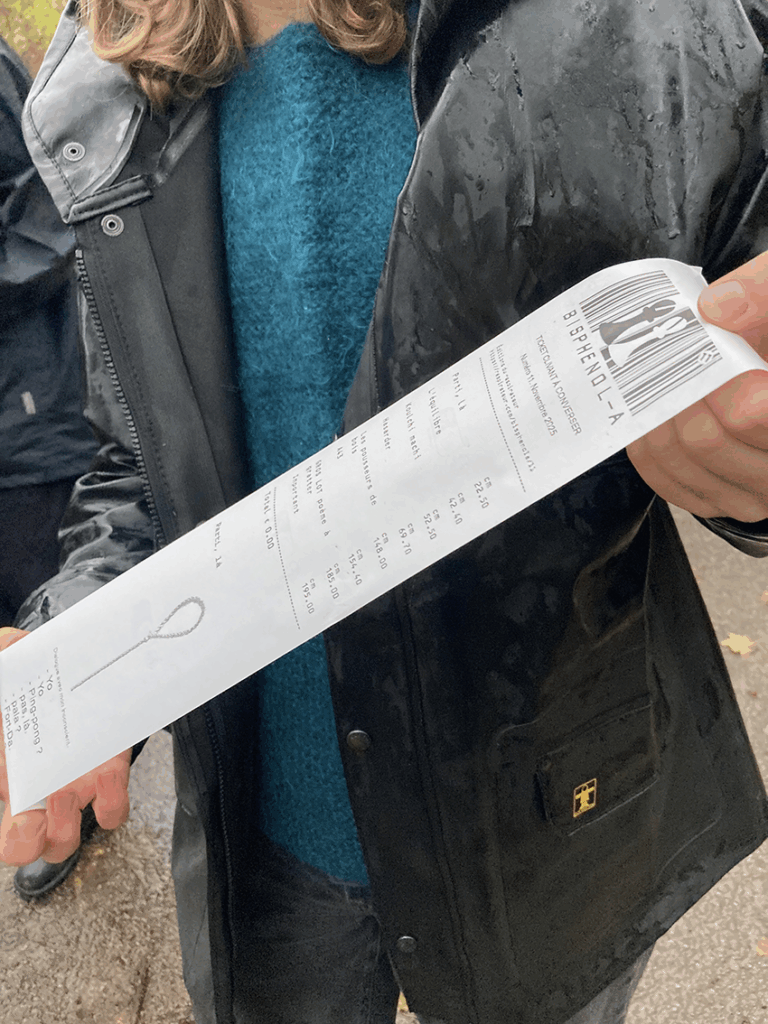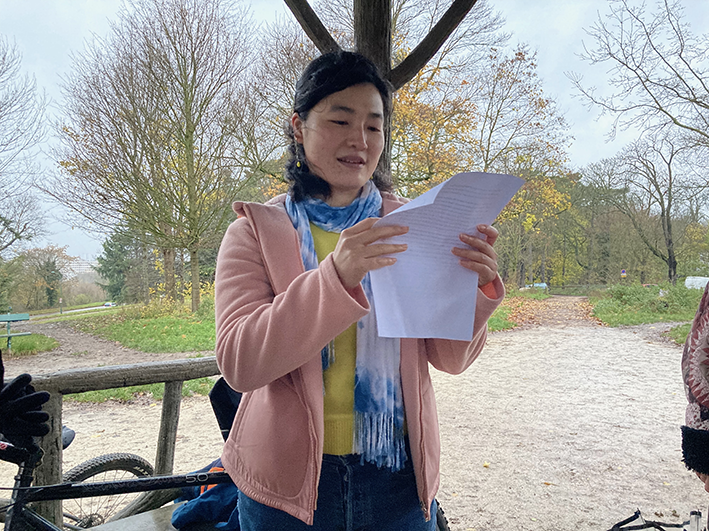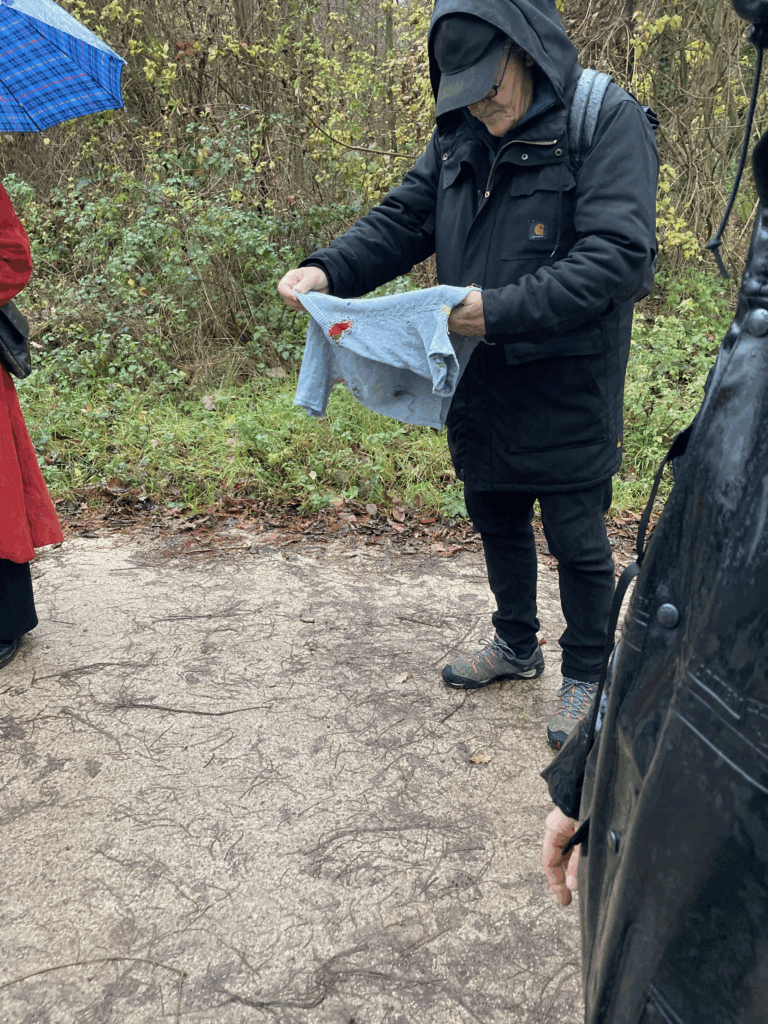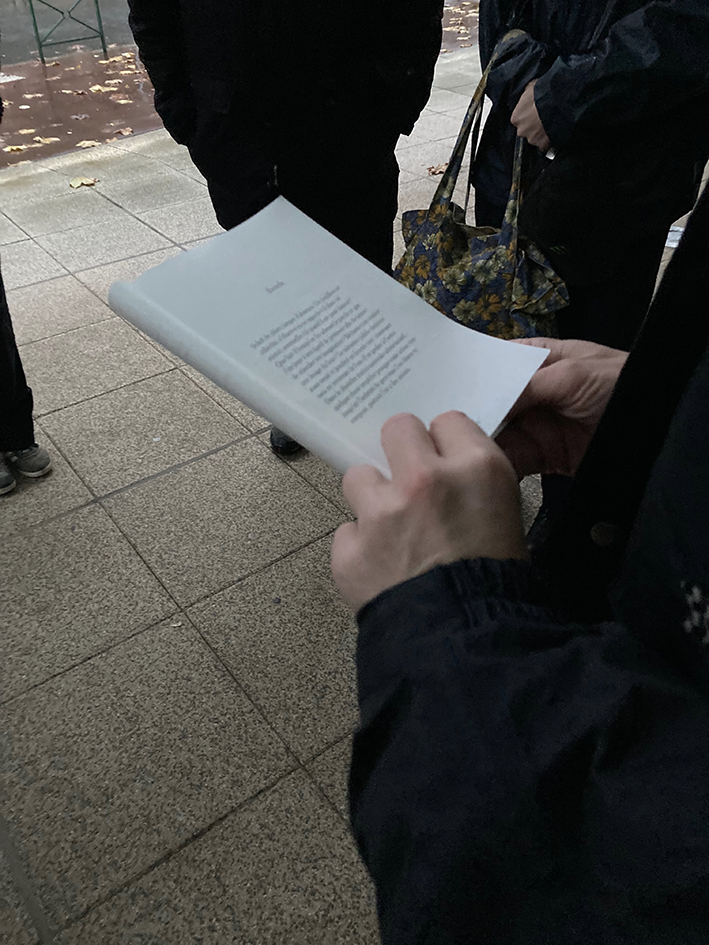Boulevard de la Villette, Paris 10ᵉ, le 26 janvier 2018
Je supporte assez bien la chaleur tant que je peux marcher à l’ombre et boire lentement, je sais que si l’eau est trop fraîche ma gorge se contracte et la toux arrive comme une sanction immédiate. Je n’aime pas laisser de nourriture dans mon assiette parce que j’ai grandi avec l’idée que tout devait être terminé, qu’on ne jetait rien. Je m’arrête souvent devant les plaques de rue pour lire leur nom et imaginer ce qu’il y avait là avant. Je ne fume plus depuis la naissance de ma fille aînée, certains jours l’odeur du tabac froid me rappelle une version de moi que je ne reconnais plus. Je regarde souvent les nuages sans chercher à leur donner de formes, seulement leur vitesse, leur direction. Quand je me regarde dans un miroir, c’est le visage de mon père qui me revient, surtout le contour des yeux et le bas du visage. Nous avons le même sourire. Je n’ai jamais compris ce que certains hommes appellent avoir un type de femmes, les femmes que j’ai aimées ne se ressemblent pas du tout, c’est peut-être leur seul point commun. Je me lave tous les deux jours. La margarine me dégoûte. J’ai la réplique facile et je joue avec les mots comme avec une pièce qu’on fait tourner entre ses doigts. Mon œil gauche est légèrement plus ouvert que le droit, je le remarque quand je me vois en photo. Dessiner des spirales sur une feuille me calme quand je n’arrive plus à penser. Je ramasse parfois des cartes à jouer dans la rue et je les garde sans trop savoir pourquoi. Le mot consigne me fait penser aux bouteilles de mon enfance plutôt qu’aux règles à suivre, je préfère les chiens sans jamais en avoir eu un. J’allume la télévision pour qu’elle parle à ma place, je n’ai jamais payé pour du sexe et l’idée même me met mal à l’aise. Je sens que mon désir se déplace vers des femmes plus jeunes sans que je comprenne ce que signifie cette évolution. Je ne peux pas aller à la mer sans me baigner. Je redoute l’hiver comme on redoute un rhume inévitable. Je n’ai jamais fait grève. Je ne suis jamais allé en Turquie. Il m’arrive de parler seul à voix haute dans la rue, de marcher les yeux fermés pour tester mon équilibre. J’aime les défis inutiles. Je pense aux objets qui pourraient prendre vie s’ils duraient cent ans. J’aime la bière et le vin blanc. J’ai peur de vieillir mais je n’ai pas peur de mourir. Un regard trop insistant peut encore me faire rougir. Je me dis de plus en plus souvent que j’aimerais vraiment arrêter de travailler.
Je me lève toujours du pied gauche sans y penser. Je laisse l’eau couler trop longtemps avant de me laver les mains. Chez moi, je garde les fenêtres entrouvertes même en hiver, sinon j’ai l’impression d’étouffer. Je n’aime pas les conversations trop organisées. Je mange les fruits en commençant par les parties que je préfère le moins. Je regarde les horaires des trains sans avoir l’intention de voyager. Je ne sais pas expliquer pourquoi certains lieux me rassurent. Je garde les cartons et les emballages de la plupart des objets que j’achète. Je m’arrête parfois pour écouter des bruits que les autres ne remarquent même pas, le moteur de mon réfrigérateur, le mécanisme de l’horloge, le son de gouttes de pluie que font les doigts qui tapent un texte sur un clavier d’ordinateur. Je n’aime pas qu’on me touche l’épaule, ou qu’on me tienne le bras. Je parle rarement de mes projets parce que j’ai peur qu’ils perdent tout intérêt une fois énoncés. Je préfère les rues secondaires aux grandes avenues. Je lis les notices d’utilisation comme si c’étaient des récits épiques. Je me souviens de phrases entendues à la volée dans la rue ou dans les transports en commun. Je laisse refroidir les plats avant de les manger. Je n’aime pas qu’on me regarde manger. Je collectionne des mots que je n’utilise jamais. Mordoré. Porphyre. Sabayon. Je regarde les photos anciennes sans chercher à savoir qui sont les personnes dessus. Je marche parfois en comptant mes pas. Je m’ennuie la plupart du temps dans les fêtes, je ne sais pas quelle attitude avoir, je ne m’y sens pas à ma place, gauche, mal à l’aise. Je n’apprécie pas qu’on m’appelle par mon prénom dans les lieux publics, je trouve ça trop familier. Je regarde la pluie depuis l’intérieur de mon appartement sans ouvrir la fenêtre. Je préfère les voix graves aux voix aiguës. Je ne sais pas dire au revoir correctement. Je m’arrête souvent au milieu d’un geste sans savoir ce que je cherchais à faire.
#163 Sur le banc (1)
#167 Sur le banc (2)
#188 Sur le banc (3)
#194 Sur le banc (4)
#199 Sur le banc (5)
#204 Sur le banc (6)
#214 Sur le banc (7)
Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci